 |
LE VIAUR :le châtaignier. |  |
|---|
Texte de Gérard BRIANE Maître de Conférences à l'Université de Toulouse. Illustrations en couleur de Claude Bernard 81190 Mirandol. Photos de Suzanne Calmettes, Pierre Fuentes et Thierry Couët. |
|||
Le châtaignier (Castanea sativa) a, de tout temps, constitué une ressource essentielle des régions pauvres de Bretagne, du Limousin, des Ségalas, des Cévennes, des Maures, de Corse: c'était l' "arbre à pain". On a même parfois parlé d'une "civilisation du châtaignier" ou le châtaignier était la base de la nourriture pour l'homme et les animaux, servait de bois de chauffage, de bois d'oeuvre, son feuillage était utilisé pour la litière, etc... |
|||
|
|||
Un arbre de civilisation C'est à partir de là que le châtaignier et l'homme ne se sont plus quittés. Le châtaignier a été l'élément essentiel de la survie de nombreuses populations des secteurs de moyenne montagne anciennes comme le Massif-Central, les Cévennes ou la Corse, C'est souvent grâce à cet arbre providentiel que les densités de population ont pu être aussi élevées dans ces montagnes aux XVIII et XIX ème siècles (souvent même bien plus élevées que dans les plaines fertiles du nord de la France). La civilisation agraire des régions castanéicoles était basée sur le pré-châtaignier. Il s'agissait d'associer à un verger de châtaignier où les arbres sont plantés et greffés, la culture de céréales (essentiellement du seigle: région du Ségala) ou la prairie pâturée par les animaux domestiques. Ces associations de pratiques culturales permettent souvent, dès le milieu du Moyen-Age, à des régions pauvres de faire face à la famine. Les échanges de greffons et de variétés sont fréquents et contribuent au brassage génétique des variètés à travers tout le sud de l'Europe. |
|||
  |
Un arbre de civilisation Si le fruit est l'élément essentiel de cette civilisation du châtaignier, pratiquement toutes les parties de l'arbre sont utilisées. Les châtaignes servaient de nourriture aux agriculteurs, (autoconsommation) qu'elles soient utilisées fraîches ou séchées (dans des «Sécadous » et sur des « claides») pour être consommées sous forme de farines, comme on peut le voir , encore aujourd'hui en Corse. Elles étaient aussi commercialisées et servaient de monnaie d'échange contre du froment, du vin, de l'huile ou des épices. Mais la châtaigne servait surtout dans bien des régions Limousin, Cévennes, Vivarais, Béarn, sud du Massif Central) à l'engraissement des cochons qui en ont fait une spécialité du Rouergue ou des Monts de Lacaune. L'utilisation « de luxe» de la châtaigne sous forme de marrons glacés ou de crème est, quand à elle, relativement récente. D'ailleurs la distinction entre châtaignes et marrons, les derniers comportant moins de 12% de cloisons pour 100 fruits, n'est apparue que dans les années cinquante. C'est aussi le bois qui sert à la construction de meubles, d'échalas, de parquets, etc.. Quand les arbres étaient coupés, le taillis issus des nombreuses repousses servait à l'obtention de piquets. Les régions viticoles avaient ainsi de nombreux échanges avec les régions de castanéiculture: elles fournissaient les piquets et le bois pour la construction des tonneaux en échange du vin. Enfin, les feuilles servaient à la litière des animaux, souvent en association avec des fougères. Elles servaient aussi d'engrais dans les cultures. Elles pouvaient aussi servir, après émondage, de fourrage pour les animaux soit fraîches, soit après séchage en hiver. Les feuilles fraîches pouvaient aussi servir à envelopper des fromages frais ou à tapisser les fonds des paniers.
|
 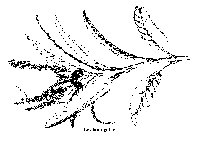 |
|
Un arbre en voie de disparition ?
|
|||
Ce renouveau se fait au travers de l'amélioration des pratiques culturales et surtout grâce à l'amélioration des variétés de châtaigniers. Certaines sont trés anciennes et sont de plus en plus difficiles à trouver (voir encadré). D'autres variétés ont été sélectionnées par l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique). Certaines variétés sont issues de l'hybridation, naturelle ou artificielle, entre deux espèces: le châtaignier européen (Castanea sativa) et le châtaignier du Japon (Castanea crenata). Elles sont généralement plus résistante à la maladie de l'encre que les variétés indigènes. C'est le cas de variétés comme Marigoule, Marsol, Bournette ou Bouche de Bétizac. D'autres variétés sont anciennes et avaient plusieurs usages. Elles étaient toutes greffées, le plus souvent en sifflet («la caramelle») à partir d'arbres greffés et taillés spécialement pour fournir les greffons (" gruelle")) : les « gruelliers». En vallée du Viaur, on a pu recenser plusieurs variétés :
|
|||
UN VERGER CONSERVATOIRE : Tout ce patrimoine biologique aujourd'hui menacé est conservé au Verger Conservatoire Départemental à la ferme de La Croix Blanche à Rignac (Aveyron). |
|||