 |
LE VIAUR : les barrages. |  |
|---|
Il faut distinguer : - d'une part les barrages amont qui forment un système, que l'on peut globalement appeler, le "système Pareloup" -d'autre part le barrage de Thuriès en aval . Enfin, les micro-centrales qui sont installées sur d'anciennes chaussées de moulin et ne créent pas de retenues d'eau importantes. |
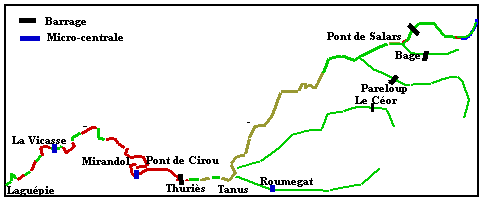 |
||
 |
Pareloup :Construit de 1949 à 1951, ce barrage de 43,45 mètres de haut est situé sur un affluent du Viaur : le Vioulou. Avec 1260 ha et une contenace de169 hm3, il s'agit de la 16ème réserve française, elle est alimentée, en plus des eaux du bassin versant du Vioulou, par un système de pompage des apports du Céor, du Bage et du Viaur qui sont stockés dans les retenues du Céor, de Bage et de Pont de Salars (voir carte). L'essentiel des eaux de ce barrage est transféré, via l'usine d'Alrance, vers l'aménagement hydroélectrique du Pouget sur le Tarn qui reçoit donc ainsi une partie des eaux du bassin versant du Viaur. Une partie des eaux alimente la ville de Rodez et le syndicat des eaux du Ségala. |
||
Les impacts des barrages sur la rivière
|
|||
Thuriès :Plus petit (1,3 M de m3), ce barrage à vocation hydroélectrique fonctionne par éclusées, parfois importantes (jusqu'à 22m3/s, ce qui dépasse nettement le débit moyen du Viaur à cet endroit : une dizaine de m3). En août 1996, la DRIRE (Direction Régionale de l'industrie de la Recherche et de l'Environnement) a exposé les problèmes posés par le renouvellement de la concession du barrage de Thuriès â EDF. La retenue pourrait jouer le rôle de soutien d'étiage du Viaur. Cela conduirait à un marnage pouvant aller jusqu'à trois mètres. La DRIRE consulte dans ce dossier les collectivités locales et les associations concernées par la situation. Toute la population de la vallée en aval de Thuriès a gardé de très mauvais souvenirs de la vidange de ce barrage et la question du soutien d'étiage avait été donc largement discutée et commentée par l'assemblée générale de l'association Viaur-Vivant. La DRIRE, les préfectures et EDF ont donc été informées de notre point de vue que nous résumons ci-dessous. La première question qui se pose est l'intérêt de ce soutien d'étiage. Le Viaur a bien entendu, en été, un débit faible, en moyenne entre un et deux m3/s parfois moins. Un bas niveau d'étiage provoque des nuisances graves : mortalités piscicoles, tourisme canoë gêné, pollution par eutrophisation ; ce qui handicape baignade et alimentation en eau potable. De fait, cette situation n'existe qu'en cas de sécheresse prolongée ou si l'on fait d'importants stockages d'eau dans les barrages (Thuriès, Pont de Salars, Pareloup). Ces cas de figure ne sont pas réguliers, heureusement. Donc le soutien d'étiage ne semble guère nécessaire systématiquement. En fait il semblerait que ce soutien d'étiage ne concerne pas le Viaur lui même mais son aval où les besoins en eau sont plus importants. Ceci étant posé, VIAUR-VIVANT n'est pas hostiles par principe a un soutien d' étiage Si certaines conditions sont garanties :
Ces conditions sont sans doute incompatibles avec la production d'électricité qui provoque lors du turbinage des lâchers d'eau massifs et irréguliers mais elles nous semblent garantir un bon état des eaux pour ses divers usages (tourisme, pêche, pompages d'eau qui alimentent les communes environnantes). Il faut enfin souligner que la capacité de la retenue de Thuriès est assez faible (6.5 millions de m3) et qu'utiliser celle-ci comme soutien d'étiage avec un débit un peu important amènerait rapidement un marnage bien supérieur aux trois mètres évoqués. A la suite de nos courriers, E.D.F nous a répondu qu'il était peu réaliste d ' envisager Thuriès comme réservoir de soutien d'étiage, entre autre à cause de la faiblesse de la capacité utile : 1,3 million de m3, soit un soutien de quinze jours au rythme de I m3/s. E.D.F a également précisé que la loi eau (voir dossier sur le SDAGE} imposait un débit restitué à l'aval du barrage de 1,73 m3/s, ce qui allait mettre à l'arrêt la centrale hydro électrique du 13 juin à fin septembre. La restitution d'eau se ferait en partie par le fond et en partie par la surface. Nous avons rappelé alors notre hostilité à des lâchages trop importants par les vannes de fond.
|
Assemblée générale 2003 Thuriès/CharlasL' Assemblée Générale de notre association, s’est penchée sur le problème de la gestion de l’eau localement (Thuriès) et dans la région Midi-Pyrénées (Charlas). Voici ci-dessous la teneur des courriers envoyés : Nous tenons d’abord à souligner que nos membres ne sont pas, par principe, hostiles à un soutien d'étiage à partir du barrage de Thuriès, même si ce soutien concerne en fait, non pas le Viaur, mais son aval c’est à dire la rivière Aveyron et la Garonne. La nécessaire solidarité dans la gestion des eaux est un principe de base auquel nous adhérons mais à condition que les précautions ci-dessus rappelées, soient garanties. Cet été, le Préfet de Tarn et Garonne qui gère le plan de gestion des étiages a décidé d’utiliser la totalité de la réserve de 1.1 million de m3 d’eau du barrage (abaissement de 3 mètres du niveau d’eau) de Thuriès pour pallier les effets de la sécheresse. A cette décision, justifiée par la situation de crise hydrique, s’est ajouté l’abaissement anticipé (plus d’un mois avant la date prévue) des eaux pour la visite décennale d’E.D.F. C’est par la presse que la population locale et les élus ont appris ces décisions… Et c’est en une semaine que l’essentiel des lâchers d’eau a été effectué provoquant un abaissement brutal du niveau du barrage et une montée tout aussi brusque des eaux du Viaur. Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Pampelonne s’est ainsi trouvé dans une situation critique pour assurer l’alimentation en eau des 1500 habitants du secteur. |
||
Les eaux de THURIES.E.D.F, qui produit de l'électricité sur le site de Thuriès, a commandé au laboratoire d'hydrobiologie de l'Université Paul SABATIER de Toulouse un certain nombre d'études scientifiques pour mieux gérer la retenue. Parmi celles-ci un dossier sur un phénoméne que les riverains de la retenue ne peuvent pas ignorer : la prolifération des algues, notamment l'été. Une étudiante de Paul Sabatier, Florence SEGUIN a soutenu en septembre 1997, un D.E.A d'écologie dont le mémoire porte sur le cycle des algues dans le lac de Thuriès (sous la direction d'un professeur spécialiste des algues René LE COHU). Précisons que le compte-rendu qui suit ne donne pas un aperçu fidèle de ce travail très technique et très spécialisé mais qu'il en extrait seulement quelques éléments et conclusions. Pourquoi et comment la retenue de Thuriés fabrique t'- elle ces algues ? Pour répondre â la question, Florence Seguin a mesuré l'évolution d'un certain nombre de paramètres (par des prélèvements réalisés en 1997), notamment la température, l'oxygénation, les teneurs en matières azotées. Qu'en résulte t'- il ?
Si les eaux de surface au printemps sont relativement froides : 8°C en avril, elles peuvent être trés élevées dès la fin mai 24°C le 27 mai (record 27°C le 12 juin). Elles diminuent fortement en profondeur : â 14 mètres, le 27 mai la température était divisée par deux par rapport à la surface (120C). Mais Si de violents orages interviennent, ils homogénéisent un peu les températures.
La quantité dissoute décline rapidement en profondeur surtout quand la température s'élève. Ainsi, en juin, on constate que dès une profondeur de deux mètres l'oxygène dissout diminue considérablement. Au fond, l'oxygène est absent.
On relève de fortes teneurs en nitrates (2,5 à 4 mg/l sur toute la colonne d'eau) ainsi que des concentrations importantes d'azote total (nitrates plus nitrites plus azote ammoniacal) et de phosphore. Tous les facteurs ci-dessus placent le lac de Thuriès dans la catégorie des lacs "hypereutrophes" ou l'abondance de nutrirnents et la faible teneur en oxygène favorisent le déséquilibre biologique et une importante biomasse algale. Consolation, la zone euphotique (éclairée par le soleil) qui varie actuellement de 6 mètres de profondeur en moyenne et jusqu'à dix mètres (l'été) est encore convenable. Si ce critère se dégradait également, la qualité des eaux, déjà mauvaise serait encore bien pire... |
|||